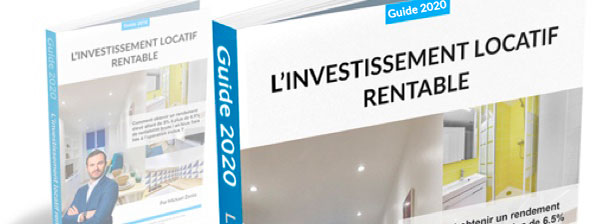Location saisonnière en SCI : faisabilité, fiscalité et conséquences commerciales

L'attractivité de la location saisonnière, portée par des plateformes comme Airbnb et Booking.com, séduit de plus en plus d'investisseurs. Générer des revenus locatifs substantiels en période de forte demande, notamment en zones touristiques, est une perspective financière tentante. Cependant, lorsque le bien immobilier est détenu au travers d'une Société Civile Immobilière (SCI), cette apparente simplicité se heurte à une réalité juridique et fiscale complexe.
La SCI est, par essence, une structure civile destinée à la gestion patrimoniale et à la location nue. Or, la location saisonnière meublée est considérée par le droit français comme une activité commerciale. Cette divergence fondamentale soulève une question importante : est-il possible, et surtout pertinent, d'exercer une activité de location saisonnière au sein de votre SCI sans faire basculer l'équilibre juridique et fiscal de votre société ?
La location saisonnière est-elle compatible avec l'objet civil de la SCI ?
Pour appréhender la problématique de la location courte durée en SCI, il est indispensable de revenir aux fondamentaux juridiques de cette structure. L'objet social d'une SCI est par définition civil. Toute incursion dans le domaine commercial peut entraîner des conséquences majeures.
Définition et distinction entre activité civile (location nue) et activité commerciale (location meublée saisonnière)
La distinction entre activité civile et commerciale est la pierre angulaire de la fiscalité des SCI. L'activité civile se résume à la simple gestion et mise en location de biens immobiliers dans un état non meublé.
L'activité civile
Elle englobe la location nue (non meublée) classique. Les revenus perçus sont des revenus fonciers, imposables à l'Impôt sur le Revenu (IR) directement au niveau des associés, selon leur quote-part. Le but est la jouissance du bien et sa gestion passive.
L'activité commerciale
Elle est caractérisée par la fourniture de prestations de services ou l'exercice d'actes de commerce. C'est ici que la location meublée, et a fortiori la location saisonnière, fait son entrée. La mise à disposition d'un logement meublé implique des services (literie, ustensiles, ménage, fourniture d'eau/électricité/gaz) qui vont au-delà de la simple gestion immobilière. L'article 34 du Code Général des Impôts (CGI) classe les revenus de la location meublée dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
La location saisonnière (ou location courte durée) est l'archétype de l'activité commerciale. Elle se distingue de la location meublée classique par sa fréquence élevée de rotation des locataires, qui accentue le caractère de prestation de services hôteliers. Le fait d'encaisser des recettes BIC par une SCI initialement civile crée une situation de mélange des genres que l'administration fiscale observe avec une vigilance extrême. Si l'activité commerciale devient prépondérante, la SCI est immédiatement et irrévocablement soumise à l'Impôt sur les Sociétés (IS).
Les conditions de la tolérance fiscale : l'activité résiduelle (la règle des 10%)
Face à cette dichotomie, l'administration fiscale a mis en place une doctrine de tolérance visant à ne pas pénaliser immédiatement les SCI qui génèrent accessoirement des recettes commerciales. Cette tolérance est encadrée par une règle simple et stricte : la règle des 10%.
Pour qu’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) puisse conserver ce régime, l’activité commerciale qu’elle exerce, comme la location saisonnière meublée, doit rester accessoire et très minoritaire. Deux conditions encadrent cette tolérance :
- Le Seuil de Tolérance : Le montant des recettes issues de l'activité commerciale (BIC) ne doit pas excéder 10% du montant total des recettes hors taxes de la SCI pour l'exercice.
- Les Recettes Commerciales Prises en Compte : Il s'agit du chiffre d'affaires généré par la location meublée (saisonnière ou non), déduction faite des charges spécifiques à cette activité.
Dès que les recettes de la location saisonnière dépassent ce seuil de 10%, même pour un seul exercice fiscal, la SCI perd le bénéfice de son statut civil à l'IR et bascule automatiquement et irrévocablement à l'Impôt sur les Sociétés (IS). Cette bascule est l'épée de Damoclès qui pèse sur toute SCI s'aventurant dans la location saisonnière lucrative.
Points clés à retenir sur la règle des 10% :
- Elle s'applique au montant des recettes HT, non pas aux bénéfices.
- Le dépassement du seuil est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière possible à l'IR, même si les recettes BIC repassent sous les 10% les années suivantes.
- Le calcul doit être mené avec une extrême rigueur, car l'administration fiscale ne fait preuve d'aucune mansuétude en cas de dépassement, même minime.
Pour une SCI qui souhaite maximiser son rendement locatif par le biais de la location saisonnière, dépasser ces 10% est souvent l'objectif même de l'opération, ce qui rend la conservation du régime à l'IR quasiment impossible. Cela nous amène directement à la conséquence la plus lourde de ce choix d'activité.
Le virage fiscal inéluctable : SCI à l'IR face à l'Impôt sur les Sociétés (IS)
Une fois le seuil de tolérance franchi, la SCI change de nature fiscale, passant d'une entité transparente fiscalement (IR) à une personne morale pleinement imposable (IS). Ce changement a des répercussions considérables sur la gestion, la fiscalité des associés et la valorisation du patrimoine.
Conséquences du passage automatique à l'IS pour la SCI qui loue en meublé de manière habituelle
Le basculement sous le régime de l'Impôt sur les Sociétés est un événement majeur qui modifie radicalement les règles du jeu pour les associés et pour la société elle-même.
Premièrement, le bénéfice de la SCI est imposé au niveau de la société, selon le taux de l'IS (taux normal ou taux réduit). Les associés ne sont imposés que sur les dividendes qu'ils décident de se verser. On parle de double imposition : une première fois sur les bénéfices de la société, et une seconde fois sur les dividendes distribués (prélèvement forfaitaire unique - PFU, ou flat tax).
Deuxièmement, les règles d'amortissement changent et deviennent extrêmement avantageuses pour l'immobilier :
L'amortissement du bien
À l'IS, il est possible d'amortir la valeur du bien immobilier (hors terrain) et des meubles. Ces amortissements sont déductibles des recettes locatives, ce qui permet de réduire considérablement, voire d'annuler, le bénéfice imposable à l'IS pendant de nombreuses années. C'est l'un des grands attraits de l'IS pour l'immobilier meublé.
Le statut des déficits
Les déficits générés par les amortissements sont reportables indéfiniment sur les bénéfices futurs de la SCI, ce qui permet d’optimiser la gestion fiscale à long terme. Toutefois, cette mécanique avantageuse comporte un risque majeur au moment de la sortie, notamment lors de la vente du bien ou de la cession des parts. Deux points doivent être examinés avec attention :
Le calcul de la plus-value à l’IS
La première alerte concerne la méthode de calcul de la plus-value imposable :
- Base comptable réduite : À l’IS, la plus-value est calculée sur la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire sa valeur d’achat diminuée des amortissements pratiqués.
- Effet fiscal amplifié : Plus les amortissements sont élevés, plus la valeur nette diminue… et plus la plus-value imposable augmente artificiellement par rapport au régime IR.
- Double imposition : La plus-value est d’abord soumise à l’IS, puis les sommes distribuées aux associés sont de nouveau imposées entre leurs mains.
Une irréversibilité stratégique
La seconde alerte concerne le caractère définitif du passage à l’IS :
- Changement irréversible : Une fois la SCI passée à l’IS, il n’est plus possible de revenir au régime IR.
- Évaluation préalable indispensable : Il est donc crucial que les associés mesurent les avantages des amortissements et anticipent la charge fiscale future liée à la plus-value avant de se lancer dans la location saisonnière.
L'impossibilité de bénéficier du statut LMNP ou LMP pour les associés de la SCI
Il est essentiel de lever toute ambiguïté : les associés d’une SCI, même si elle est soumise à l’IS, ne peuvent pas revendiquer le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) ni celui de Loueur en Meublé Professionnel (LMP). Cette impossibilité s’explique par la nature même de la SCI et par la logique fiscale qui distingue les personnes physiques des sociétés. Deux points doivent être retenus :
Le foyer fiscal et la logique du LMNP/LMP
Le premier élément concerne la portée du statut LMNP ou LMP :
- Un régime réservé aux particuliers : Ces statuts s’appliquent uniquement aux personnes physiques qui exercent directement l’activité de location meublée, ou via une structure spécifique comme une EURL ou une SARL de famille.
- Différence avec la SCI : Dans une SCI, c’est la société elle-même qui exerce l’activité commerciale et qui supporte l’impôt (IS). Les associés ne peuvent donc pas imputer les déficits BIC sur leur revenu global ni bénéficier des exonérations de plus-value prévues pour le LMP.
L’exclusion formelle pour la SCI
Le second élément concerne la nature juridique de la SCI :
- Une société de capitaux ou sui generis : La SCI ne relève pas des régimes fiscaux réservés aux particuliers ou aux sociétés de personnes adaptées à la location meublée.
- Conséquence directe : Les associés d’une SCI sont donc exclus des dispositifs LMNP et LMP, même si l’activité exercée est identique à celle d’un particulier loueur en meublé.
Si votre objectif principal était de bénéficier du régime des amortissements du LMNP tout en conservant la souplesse de gestion d'une SCI à l'IR, vous devez être conscient que ce montage est impossible. L'exercice de la location saisonnière en SCI vous oblige à une analyse critique du régime IS vs la constitution d'une autre structure juridique dédiée à la location meublée.
Les implications juridiques et administratives de la location saisonnière en SCI
Au-delà de l'énorme enjeu fiscal, l'intégration de la location saisonnière dans votre SCI nécessite des ajustements sur le plan juridique et des formalités administratives lourdes, notamment liées aux réglementations locales de l'hébergement touristique.
L'obligation de modifier les statuts : mentionner l'activité commerciale
Dès que la SCI commence à exercer une activité commerciale (même dans la limite des 10% pour la tolérance fiscale à l'IR, mais a fortiori si l'activité est habituelle et lucrative), elle doit impérativement mettre ses statuts en conformité avec sa nouvelle réalité d'activité. Une fois la décision validée par l'AGE, il est nécessaire de réaliser les démarches de publicité :
- Publication d'un avis de modification dans un Journal d'Annonces Légales (JAL).
- Dépôt d'un dossier de modification au Greffe du Tribunal de Commerce (formulaire M2 ou M3, PV de l'AGE, statuts mis à jour) pour l'inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Négliger cette mise à jour statutaire est une faute de gestion qui expose le gérant à des sanctions et met en péril la régularité juridique de la société.
Les démarches réglementaires obligatoires
L'exercice de la location saisonnière n'est pas uniquement une affaire de fiscalité et de droit des sociétés ; elle est également soumise à une réglementation d'urbanisme et d'hébergement touristique très stricte, surtout dans les grandes villes ou les zones tendues.
La déclaration en Mairie
Dans de nombreuses communes, l'exploitant (la SCI) doit déclarer l'activité de location meublée de courte durée en mairie. Un numéro d'enregistrement unique est souvent attribué et doit être affiché sur l'annonce de location (Airbnb, etc.). Le non-respect de cette obligation est passible d'amendes administratives.
Le changement d'usage
Dans certaines grandes agglomérations (Paris, Lyon, Bordeaux, etc.), le passage d'une résidence principale à une location touristique courte durée (si le propriétaire loue plus de 120 jours par an ou si c'est une résidence secondaire) requiert une autorisation préalable de changement d'usage (passage d'habitation à commerce/hébergement). Cette autorisation est souvent difficile à obtenir et peut impliquer des compensations.
La Limite des 90 ou 120 jours
La loi impose des limites de durée de location saisonnière par an pour la résidence principale. Bien que la SCI détienne souvent des résidences secondaires, les règles locales peuvent imposer des quotas ou des restrictions spécifiques aux meublés touristiques pour lutter contre la pénurie de logements à l'année.
La SCI, en tant que personne morale, doit respecter l'intégralité de ces réglementations locales et nationales. Une SCI qui loue sans respecter le quota de jours ou sans autorisation de changement d'usage s'expose à des amendes extrêmement lourdes (plusieurs dizaines de milliers d'euros).
Location saisonnière en SCI : un levier pour optimiser vos revenus locatifs
La location saisonnière en SCI peut s’avérer très rentable, mais elle comporte des risques fiscaux et juridiques importants. La clé réside dans une gestion minutieuse des recettes commerciales pour éviter un basculement non souhaité vers l'Impôt sur les Sociétés (IS). Avant de vous lancer, il est conseillé d’évaluer l’impact de ce choix sur votre fiscalité et de vous entourer de conseils juridiques et fiscaux adaptés.
Vous souhaitez maximiser vos revenus locatifs tout en préservant l’équilibre fiscal de votre SCI ? Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé et sécurisé dans la gestion de votre investissement immobilier en SCI.
FAQ : 1. Quel type de bien peut être loué en location saisonnière via une SCI ?
La location saisonnière en SCI peut concerner tout type de bien immobilier, qu'il soit destiné à un usage résidentiel (appartement, maison) ou touristique. Cependant, la rentabilité de l'opération peut varier en fonction de la localisation du bien et de sa demande sur les plateformes comme Airbnb.
2. Les associés d’une SCI peuvent-ils pratiquer la location saisonnière sans risque fiscal ?
Non, la location saisonnière doit rester une activité accessoire dans la SCI pour ne pas risquer de passer sous le régime de l'Impôt sur les Sociétés (IS). Si elle devient prépondérante, cela entraînera une requalification fiscale.
3. Faut-il un bail spécifique pour la location saisonnière en SCI ?
Oui, la location saisonnière nécessite un contrat de location spécifique, différent du bail classique. Ce contrat doit clairement définir la durée de location et les services fournis (ménage, fourniture de linge, etc.), pour éviter toute confusion avec une location à long terme.
4. Quelles sont les démarches administratives supplémentaires à effectuer pour la location saisonnière en SCI ?
Outre la mise à jour des statuts de la SCI, vous devrez déclarer l'activité en mairie (obtenir un numéro d'enregistrement pour les plateformes de location) et, dans certaines zones, demander une autorisation de changement d'usage pour transformer un bien en location touristique.
5. Quelles sont les conséquences fiscales si une SCI dépasse le seuil de 10% de recettes commerciales ?
Si une SCI dépasse ce seuil, elle sera requalifiée sous le régime de l'Impôt sur les Sociétés (IS), ce qui entraîne une imposition sur les bénéfices au niveau de la société, avec des implications fiscales complexes pour les associés, notamment la double imposition sur les dividendes.
Ces articles pourraient aussi vous intéresser
-

L’assurance emprunteur peut être déduite des revenus fonciers sous certaines conditions, réduisant ainsi le bénéfice imposable. Opter pour le régime réel permet de déduire l’assurance emprunteur et d’optimiser la rentabilité des investissements immobiliers.
-
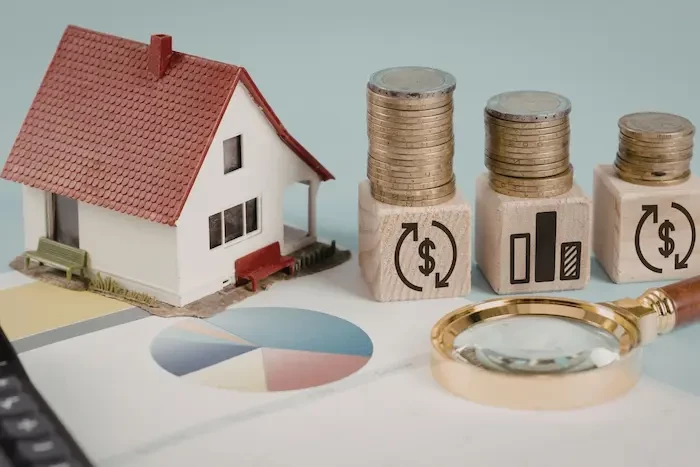
Les réformes fiscales du statut LMNP en 2026 modifient profondément les avantages fiscaux, notamment avec la suppression des amortissements sur la plus-value et des plafonds d'abattement plus stricts pour la location saisonnière. Cependant, en réorientant votre investissement vers la location longue durée et en optant pour un régime réel, vous pouvez encore maximiser vos revenus tout en respectant les nouvelles règles fiscales.
-

La réforme de l’amortissement LMNP en 2026 pourrait transformer la rentabilité des investisseurs en meublé avec de nouvelles restrictions. Il est crucial de réévaluer votre stratégie pour anticiper l’impact fiscal et minimiser les pertes.